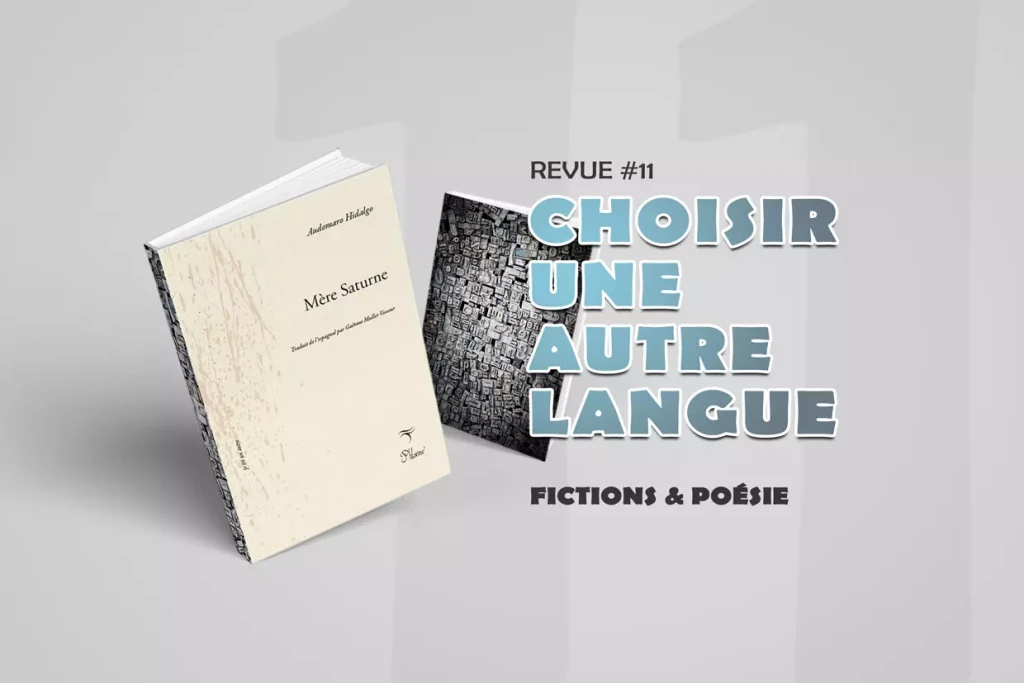
Mère Saturne, publié l’été dernier, est le deuxième livre en français d’Audomaro Hidalgo (1983), le premier étant le recueil de poèmes Les desseins de l’intempérie. Audomaro rejoint ainsi le petit groupe d’écrivains mexicains contemporains traduits en français.
Auteur plus visuel qu’auditif, il a choisi une photographie de Jorge Luis Borges et d’Octavio Paz pour évoquer la conception du temps dans l’œuvre de ces deux auteurs. Quelle meilleure façon de parler du temps que de s’inspirer d’une photographie qui a su capter un éternel présent ? Le temps est la préoccupation constante de Paz et de Borges dans leur poésie. Audomaro évoque la conception des Grecs : Chronos, Aion et Kairos ; la vivacité de Nietzsche et le temps vertical de Bachelard. Généralement écrit à la première personne, le livre mêle la prose poétique et l’essai. L’ouvrage est construit avec des phrases solides, des images claires et des idées précises. L’essai contient également des phrases controversées et discutables, qui obligent le lecteur à y réfléchir, à les contester ou à les accepter. En outre, les citations d’auteurs et de tableaux qu’il mentionne renforcent le texte.
Audomaro établit une comparaison entre les écrivains Lugones, Fernández, Vasconcelos et les contemporains ; mais aussi entre Buenos Aires et Mexico, dont il connaît bien pour avoir souvent parcouru les deux villes : il a d’ailleurs étudié la littérature à l’Universidad Nacional del Litoral, à Santa Fe, en Argentine.
Le livre, en analysant les deux écrivains latino-américains, change de temps et d’espace géographique : Buenos Aires, le Mexique, la France, en particulier le Havre, son histoire et sa géographie. Audomaro dessine la ville qu’il a en tête, sa mémoire fonctionnant comme une photographie. Sa description de l’église Saint-Joseph rappelle certaines pages de Sebald dans Austerlitz. Il n’est pas surprenant qu’Audomaro commente l’œuvre de l’écrivain allemand dans son livre.
Parmi les latino-américains, Borges et Paz sont les deux premiers à paraître en France dans la prestigieuse collection de la Pléiade (ils seront rejoints plus tard par Vargas Llosa). Lorsqu’il a appris la nouvelle, l’auteur de L’Aleph a répondu : « C’est mieux que le prix Nobel, non ? » L’écrivain mexicain, quant à lui, a déclaré : « Bon ! La Pléiade, c’est mieux après la mort. Vous ne croyez pas ? …. C’est par superstition que je dis cela. »
Audomaro nous fait également part de la constitution de sa bibliothèque : il se réfugie dans les classiques, ainsi que dans Reyes, Paz et Borges, qui se situent au même niveau que les récits de son grand-père. Le livre évoque la mort du père de Paz, écrasé par un train, celle du père de Reyes, le général Bernardo Reyes, et celle du père de Borges, lui aussi aveugle à la fin de sa vie. En fin de compte, il semble que ce soient la mélancolie et les souvenirs des morts qui construisent l’œuvre. Le présent n’est qu’un moment où défilent les visages de Paz, Borges, Reyes, le grand-père et, pour citer un extrait dans Piedra de Sol : « tous les visages sont un seul visage, tous les siècles sont un seul instant ».
Traduction L’autre Amérique
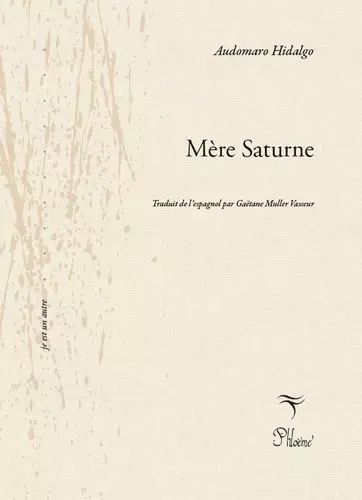
Mère Saturne d’Audomaro Hidalgo
Traduit de l’espagnol (Mexique) par Gaëtane Muller Vasseur
Editions Phloeme, 2024, 96 p. [Madre Saturno, Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco, 2020,]

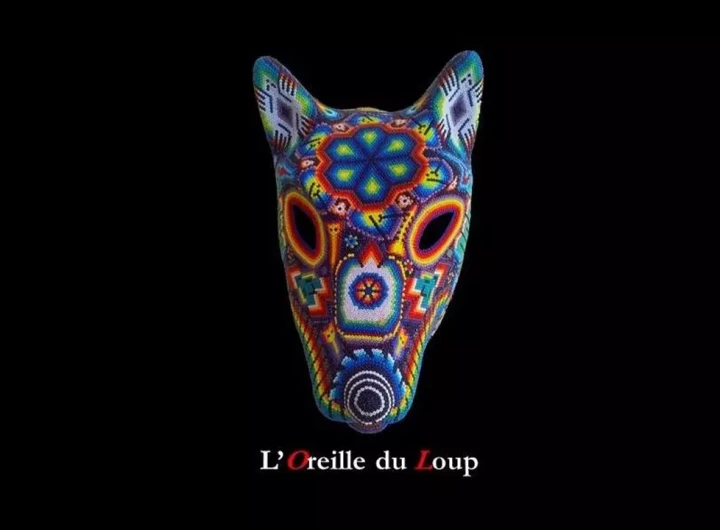 Urgence/Urgencia de Jorge Torres Medina
Urgence/Urgencia de Jorge Torres Medina 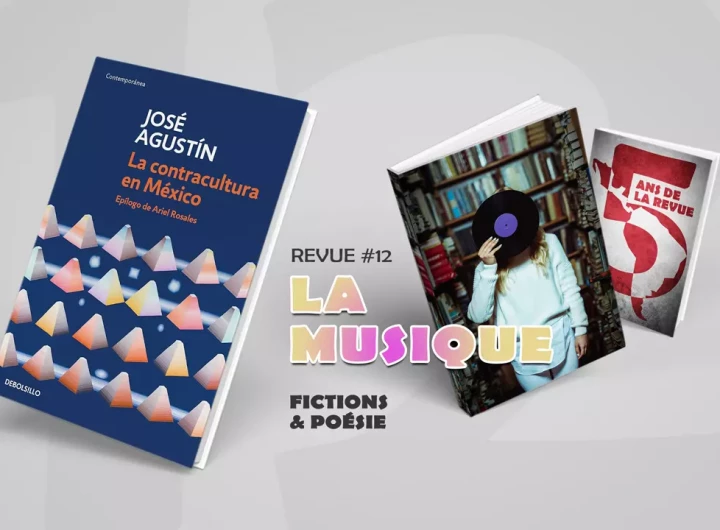 La contracultura en México de José Agustín
La contracultura en México de José Agustín 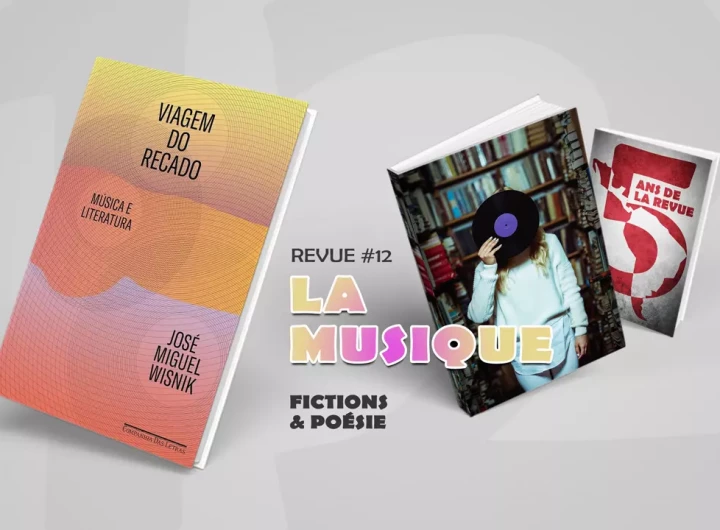 Viagem do recado: Música e literatura de José Miguel Wisnik
Viagem do recado: Música e literatura de José Miguel Wisnik 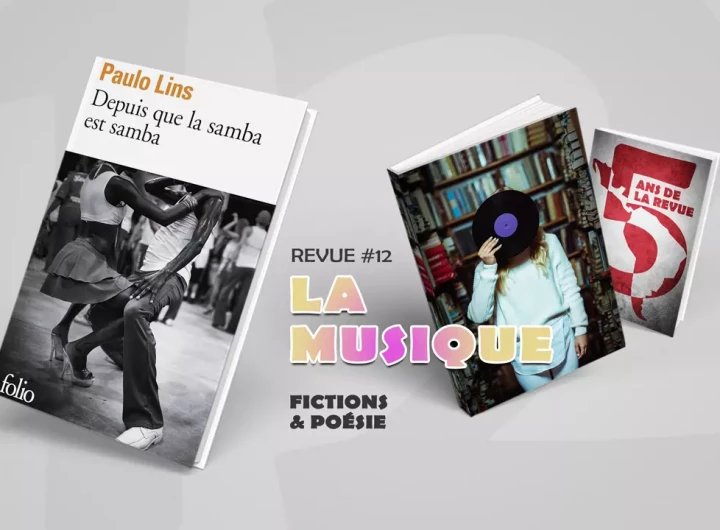 Depuis que la samba est samba de Paulo Lins
Depuis que la samba est samba de Paulo Lins 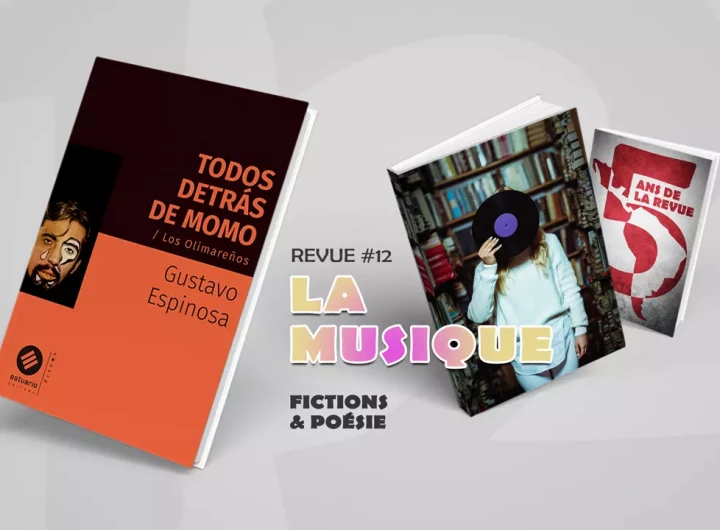 Todos detrás de Momo de Gustavo Espinosa
Todos detrás de Momo de Gustavo Espinosa