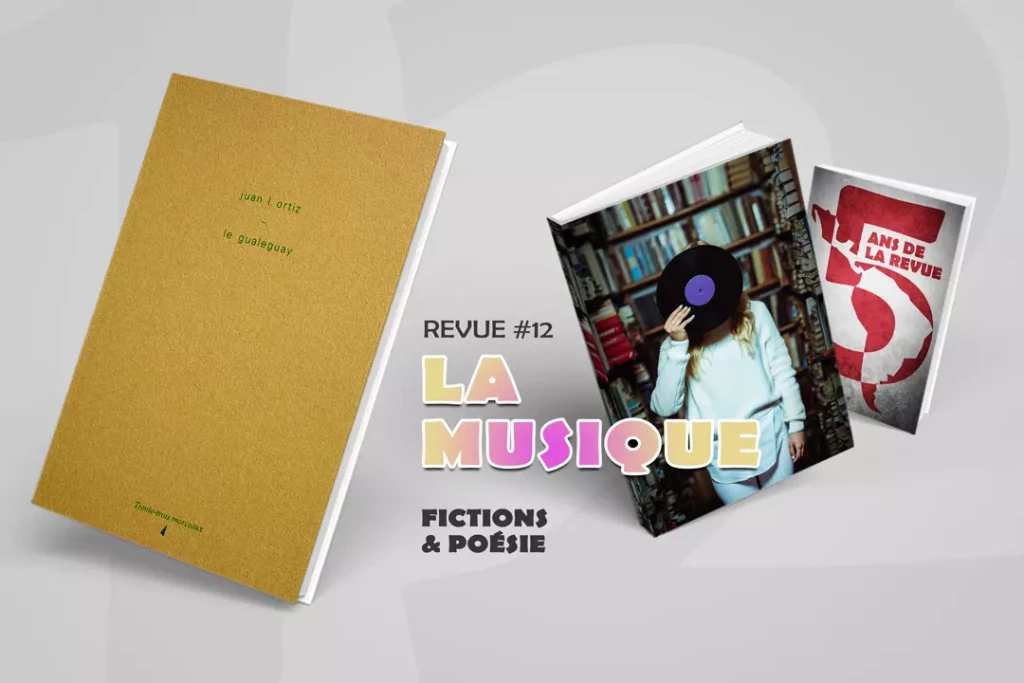
Comment traduire la musique d’un fleuve ?
Considérons un instant cette question comme une possibilité́ d’écouter plutôt que comme une certitude. Alors, en supposant qu’après l’analyse du poème-livre Le Gualeguay nous parvenions à une tentative de réponse, voici ce qu’elle serait : « le point de vue unique du poème est du fleuve, qui apprend à connaître l’Histoire par le moyen des formes et des espèces qui l’environnent, nous avons privilégié la première solution »[1], comme il est dit dans « Notes sur l’édition et la traduction ».
En ce qui concerne le poème, celui-ci ne présente pas de métrique régulière qui marque le rythme ; Juan Laurentino Ortiz (1896-1978) travaille ses vers avec une prose singulière, où interviennent le son et le sens. Semblable à cette tension entre rythme extérieur et intérieur que la critique a soulignée chez Neruda, dans Le Gualeguay, ce double élan coexiste dans un même souffle. Cependant, contrairement à la pensée syntaxique-rationnelle, la fin du rythme poétique est complétée par les intuitions et les connaissances du lecteur ; car au binôme « autobiographie » et « paysage »qui, comme le dit Sergio Delgado[2], caractérise l’œuvre d’Ortiz, il faudrait ajouter le mot « Histoire », étant donné que dans les 2 639 vers qui composent l’œuvre, l’auteur poétise depuis la « première noblesse bipède » (v. 244), en passant par une époque où « Des créatures qui semblaient dépourvues de sang/voulaient, là-bas, “réduire” leur sang… » (v. 347-348) jusqu’aux moments où, au nom du vice-roi de la couronne espagnole, Tomás de Rocamora « ceignant pour toujours la verte relation, dans l’accolade des fleuves, avec le nom qu’il lui donnerait » (v. 663 – 664).
Nous pressentons que, plus qu’il ne dit, le poème respire. Cependant, bien que tous ces mots cités aident à̀ parler du thème abordé et de la réflexion, on a l’impression qu’Ortiz travaille non plus ses vers, mais le langage de Le Gualeguay, pour paraphraser Arnaldo Calveyra, dans un mouvement vers l’extase par sa passion et par son « contenu » qui se dissipe toujours comme la brume du fleuve face à l’air et à la lumière[3].
Quelle douce chaleur — là-bas
Depuis le bassin qu’abandonnerait, quand ? la mer,
Monta en une nuée de colombe ?
Ou venait-il, lui
Avec le souffle, gris et blanc, de la mer ?
Le Gualeguay
(Fragment)
À en juger par l’attaque et l’incipit — ouverture et fragment exemplaire de versification lyrique d’un poème qui commence plus loin à prendre un accent épique —, le texte suggère le Gualeguay, sans jamais le nommer, et Entre Ríos, province où se trouve le Gualeguay, comme ce que laisse la mer en se retirant. Le poème avance entre des points de suspension et des points d’interrogation, comme si, en se suspendant syntaxiquement, il respirait en lui-même. Un effet similaire se produit entre les conditionnels et les subjonctifs, qui réaffirment un tâtonnement, presque des soupirs, qui soutiennent une musicalité donnée par les voyelles ouvertes (a, o) et fermées (i). Celles-ci génèrent une douce allitération, pas tant pour vérifier un fait, mais pour assister à l’expérience du mystère que renferme la poésie ; cet instant où la nature semble parler et où le poète hésite entre croire et imaginer.
Cependant, comme le souligne William Rowe, il existe un risque à envisager une hypothèse de lecture, car « le processus poétique (d’Ortiz) consiste à remettre en question tout ce qui peut ajouter de la certitude aux sensations »[4]. C’est pourquoi une traduction de ce type côtoie différentes frontières : non seulement celle de traduire et de créer, qui conduit à remplacer « septembre »par « avril », pour conserver la même saison d’un hémisphère à l’autre, ou cuchillas par « coteaux », pour trouver une similarité lexicale à une caractéristique géographique distincte, mais aussi la frontière de la nouveauté et de l’actualité : bien que la présente édition puisse être considérée comme une actualité littéraire, elle constitue également une nouveauté pour le lecteur argentin, puisque Ortiz n’a été traduit en français que récemment, en dépit de sa présence marquée dans la littérature argentine depuis 1950. Et même si près de cent ans se sont écoulés depuis qu’Ortiz a commencé́ à écrire les poèmes inclus dans son premier livre (El agua y la noche, 1933), la poétique d’Ortiz jouit d’une grande fraicheur. En particulier, cette œuvre, qui a été publiée en 1971 dans En el aura del sauce, un recueil de dix livres déjà publiés et de trois inédits, dont Le Gualeguay, qu’il aurait commencé à écrire en 1959.
Pour revenir à la question initiale, tout comme un interprète apparait dans l’abîme entre le motif verbal — la partition — et le motif musical — le chant —, le poète ne serait-il pas là, horizontalement et verticalement, pour faire apparaitre la musique du fleuve ? Si tel est le cas, je me permets de soutenir que le point de vue de Le Gualeguay est celui du fleuve. Je suis plutôt enclin à penser qu’Ortiz se prête comme un instrument pour traduire la mélodie cachée du Gualeguay, étant donné que « il palpitait, par-delà̀ sa musique, de toutes ces vibrations,/jusqu’à les faire siennes » (v. 150-151). Ou peut-être, finalement, ne s’agit-il pas de savoir qui parle — le fleuve ou le poète —, mais plutôt d’un texte comme lieu où les deux se croisent.
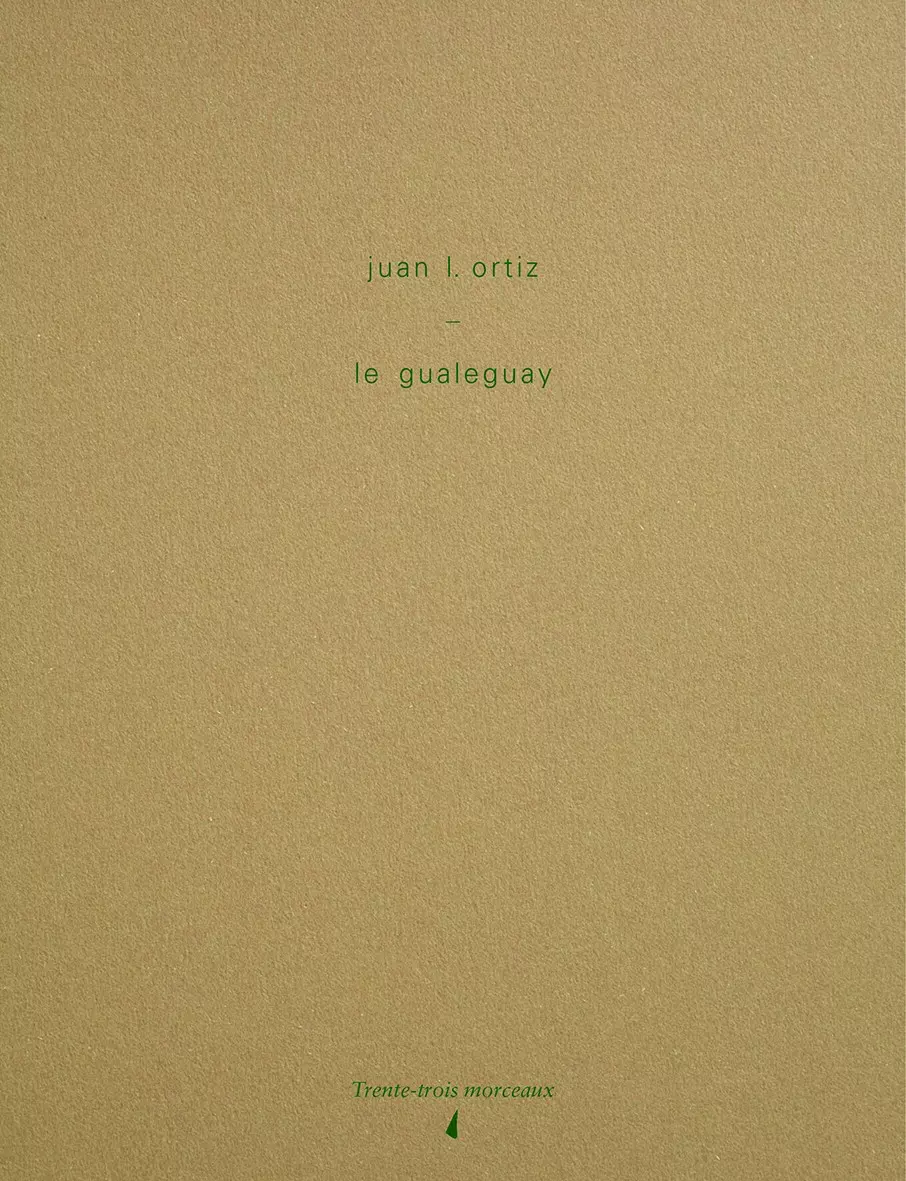
Le Gualeguay de Juan L. Ortiz
Traduit de l’espagnol par Guillaume Contré et Vincent Weber / Notes : Sergio Delgado, Guillaume Contré et Vincent Weber
Trente-trois morceaux (2022, 304 pages)
[1] Juan L. Ortiz, Le Gualeguay. Lyon, Trente-trois morceaux, 2022, p. 9
[2] Voir Dictionnaire des littératures hispaniques. Espagne et Amérique Latine (Dir. Jordi Bonnells). Paris, Bouquins, 2009, p. 1020
[3] Arnaldo Calveyra évoque cette idée dans Diario franceés (Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2012, p. 151), où il écrit : « il ne s’agit plus de mots mais de mouvement vers… », un « langage de mouvements » plutôt que d’équivalences (extraits traduits par l’auteur de cet article).
[4] William Rowe, Hacia una poética radical. Mexique, FCE, 2014, p. 210. Cité par l’auteur en espagnol et traduit en français.

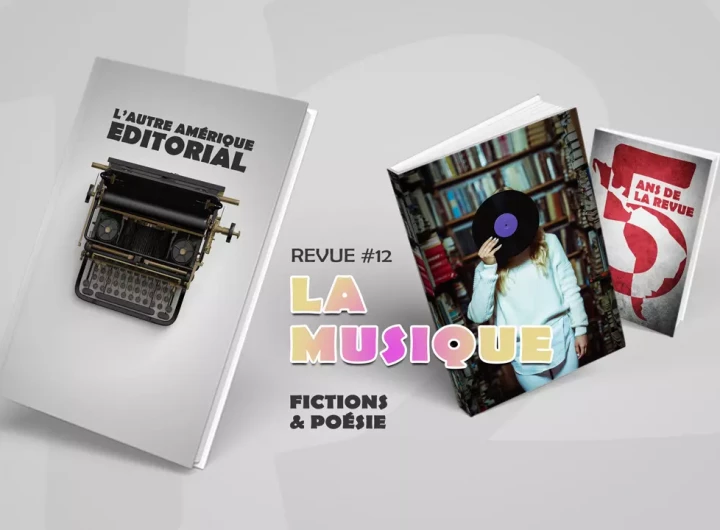 Éditorial – Musique et littérature
Éditorial – Musique et littérature 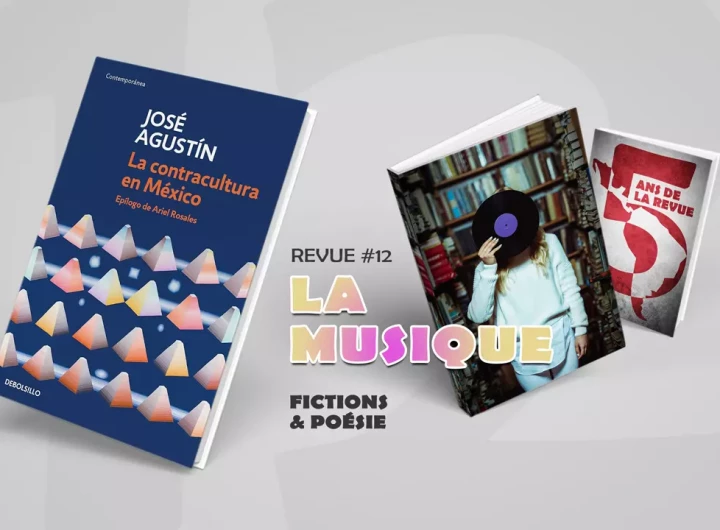 La contracultura en México de José Agustín
La contracultura en México de José Agustín 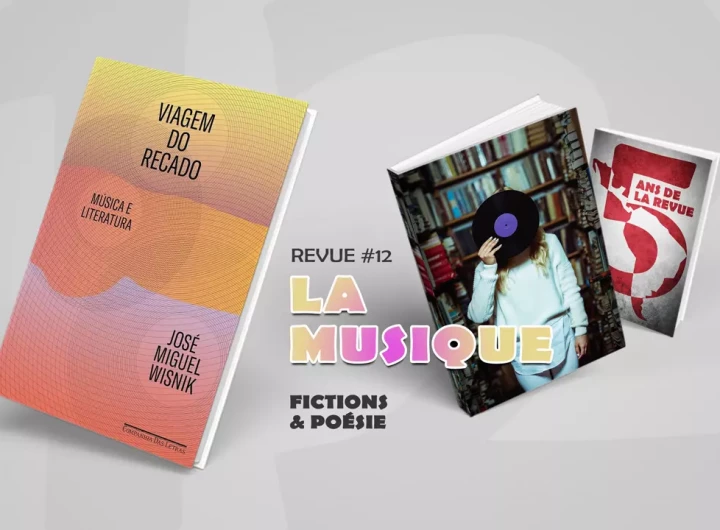 Viagem do recado: Música e literatura de José Miguel Wisnik
Viagem do recado: Música e literatura de José Miguel Wisnik  Depuis que la samba est samba de Paulo Lins
Depuis que la samba est samba de Paulo Lins 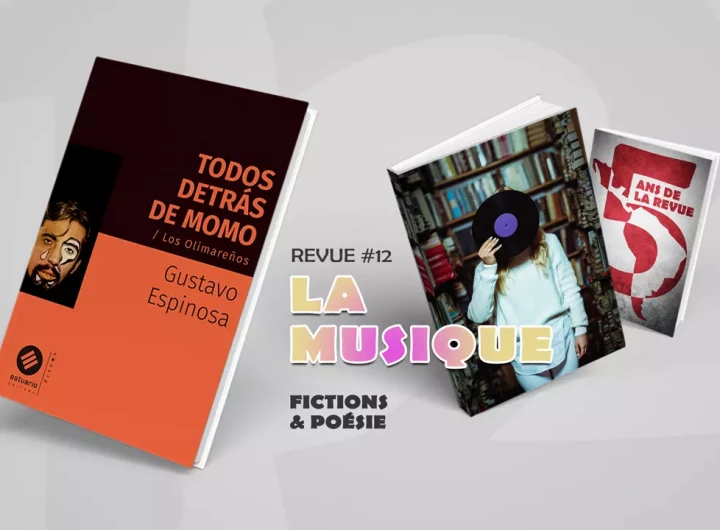 Todos detrás de Momo de Gustavo Espinosa
Todos detrás de Momo de Gustavo Espinosa